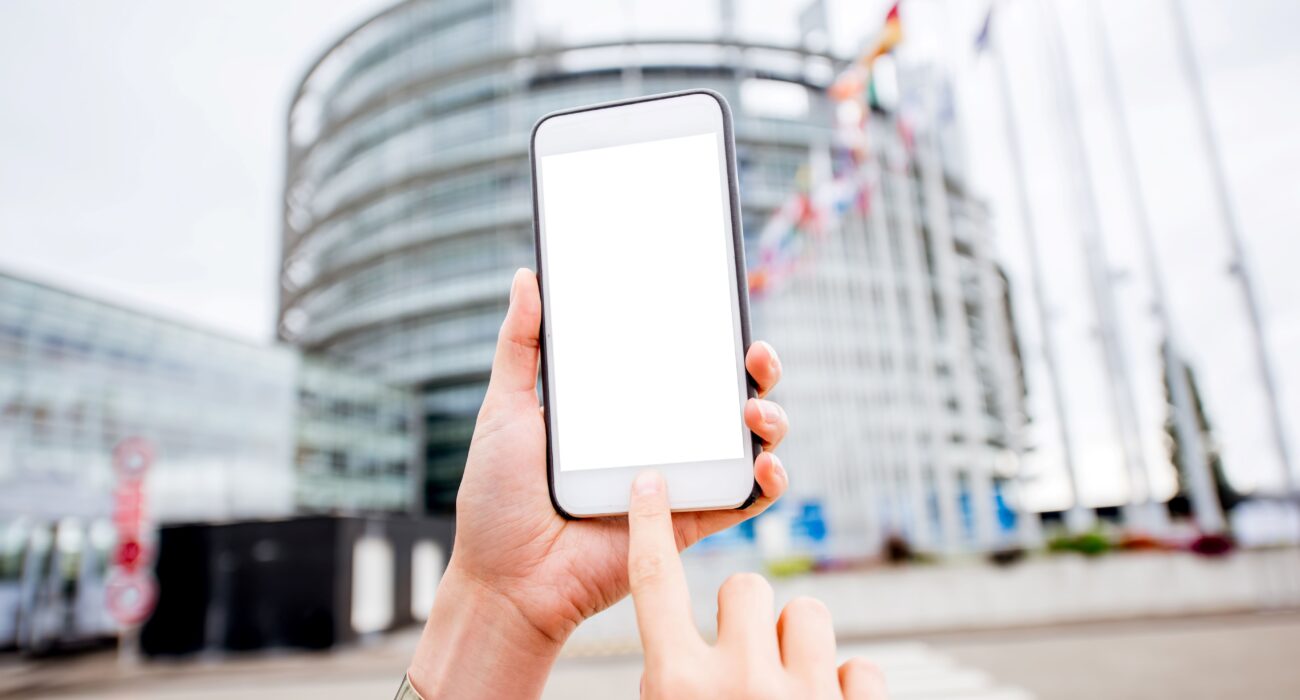La souveraineté numérique peut-elle être échangée contre des conditions commerciales plus favorables ? Pour l’Union européenne, la réponse est sans équivoque : non. Dans un contexte de tensions croissantes entre l’UE et les États-Unis, la Commission européenne a clairement indiqué que les règles régissant les plateformes numériques ne seraient pas négociées, malgré l’indignation de Washington et ses menaces de représailles commerciales.
Peter Navarro, conseiller principal du président américain, a accusé l’Union européenne de mener une « guerre juridique » contre les géants américains de la technologie. Selon l’administration Trump, les réglementations européennes sur les marchés numériques sont devenues un nouveau type de barrière non tarifaire, et ce sont elles qui empêcheraient les États-Unis de rivaliser à armes égales.
Les grandes entreprises technologiques dans le collimateur
Les enquêtes menées contre des entreprises telles que Meta, Apple, Alphabet et X (ex-Twitter) sont depuis longtemps une source d’irritation pour la Silicon Valley. La législation européenne, notamment la loi sur les marchés numériques (DMA) et la loi sur les services numériques (DSA), vise à éliminer les abus des géants de la technologie et à renforcer la protection des consommateurs.
L’approche de l’UE repose sur une présomption de position dominante : les grandes plateformes sont tenues de prouver leur bonne foi à l’avance, sous peine de se voir infliger de lourdes amendes. Les entreprises américaines parlent de discrimination et demandent l’intervention de la Maison Blanche. Ce nouveau cycle de conflit a coïncidé avec l’introduction par l’administration Trump de nouveaux droits de douane sur les marchandises européennes à hauteur de 20 %.
La position de la Commission européenne
Bruxelles n’a cependant pas changé d’avis. Les représentants de la Commission européenne insistent : la protection des droits numériques et la régulation du marché ne sont pas un sujet de négociation, mais une obligation inscrite dans le droit européen.
« Nous ne mélangerons pas les négociations commerciales avec l’application de la législation numérique », a déclaré Bruxelles. Même si ces processus coïncident dans le temps, leur logique est différente : l’un concerne les exportations d’acier, l’autre la transparence des algorithmes sur Instagram.
Quel est le cœur de la revendication américaine ?
Navarro et ses partisans insistent : l’Europe utiliserait systématiquement des formes « cachées » de protectionnisme. Leur liste comprend tout, de la TVA aux normes de qualité de la viande. Même les exigences linguistiques en matière de contenu audiovisuel ont fait l’objet de critiques.
La taxe sur la valeur ajoutée différenciée, qui varie de 17 à 27 % en Europe, est particulièrement irritante. Les États-Unis, qui ne disposent pas d’un système de TVA uniforme, y voient un outil de pression concurrentielle. En réponse à ces accusations, Bruxelles rappelle que la taxe s’applique à tous les biens, qu’ils proviennent de l’UE ou de l’extérieur, et qu’elle ne fait aucune discrimination.
Négociations sur fond de rhétorique
Pourtant, malgré les déclarations fracassantes, le format du dialogue est préservé. Les deux parties le comprennent : une rupture totale des relations économiques est impossible, surtout dans le contexte de l’instabilité du commerce mondial et des tensions géopolitiques.
Mais si les États-Unis continuent d’insister pour que la réglementation numérique soit inscrite à l’ordre du jour, il est peu probable que l’UE cède. Premièrement, cela saperait la confiance dans ses propres institutions. Deuxièmement, elle enverrait un message dangereux : les réglementations européennes peuvent être contournées si l’on insiste suffisamment.
Le conflit autour des « Big Tech » n’est pas seulement un différend sur les amendes ou l’accès au marché. Il s’agit d’un débat fondamental sur la question de savoir qui fixe les règles dans le monde numérique : les États-nations ou les multinationales. L’Europe semble déterminée à insister sur le premier point.
De leur côté, les États-Unis, en particulier sous l’administration actuelle, tiennent à protéger leurs entreprises et à maintenir leur position dominante dans la sphère technologique. Mais dans le contexte de la transformation numérique mondiale, il devient de plus en plus évident que l’ère de la supériorité absolue des plateformes américaines touche à sa fin.
Quelles sont les prochaines étapes ?
Les consultations commerciales devraient se poursuivre dans les semaines à venir. Il est peu probable que la rhétorique publique s’adoucisse, notamment en raison des pressions politiques internes dans les deux capitales. Mais une chose est d’ores et déjà claire : la législation européenne sur le numérique restera en vigueur, quelles que soient les exigences commerciales de Washington.
L’UE a mis les choses au clair : les principes de la réglementation numérique ne sont pas une marchandise. Et si les États-Unis veulent discuter sérieusement de l’avenir des relations commerciales, ils devront en tenir compte.