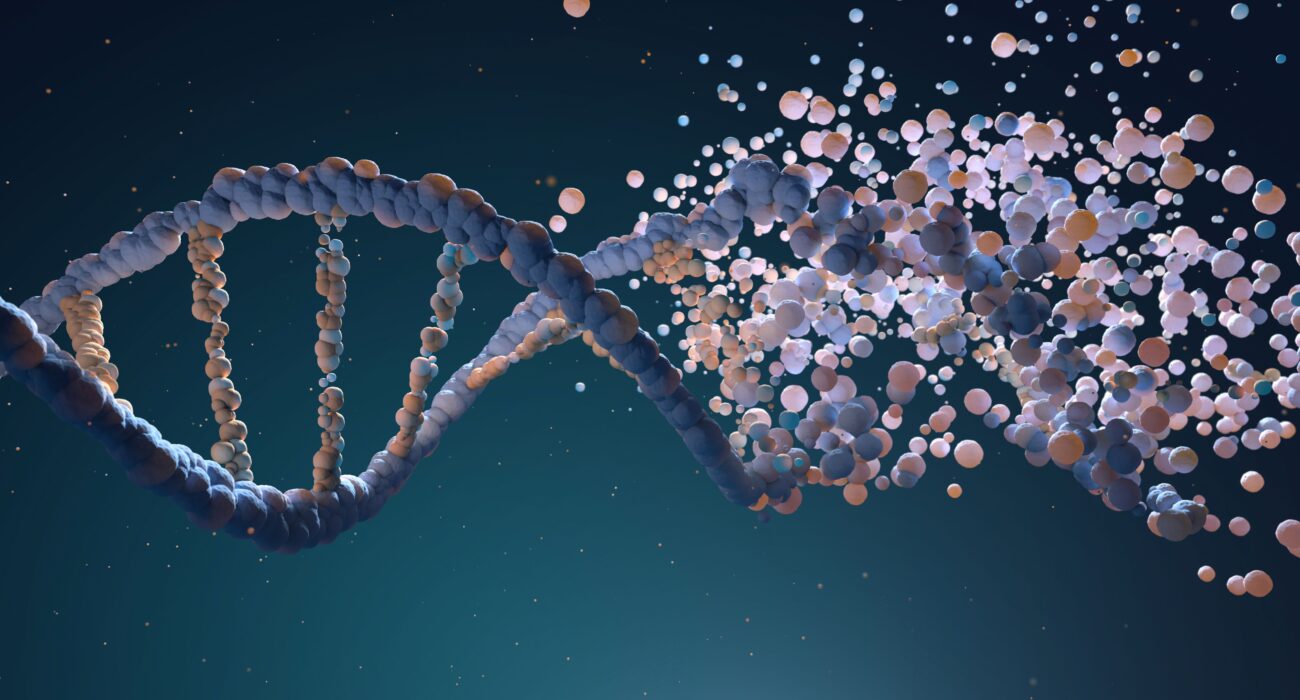À première vue, on se croirait au début d’un film de science-fiction : dans un laboratoire naissent des animaux qui ressemblent à des prédateurs disparus depuis longtemps. Ils ont une fourrure blanche comme la neige, des mâchoires musclées et une démarche assurée — presque comme les vrais loups qui régnaient sur les plaines américaines il y a des dizaines de milliers d’années. Mais en creusant un peu, on s’aperçoit qu’il ne s’agit pas d’une « résurrection », mais d’une reconstruction technologique. Une reconstruction très spectaculaire, mais une reconstruction tout de même.
L’annonce récente de la naissance de trois chiots nommés Romulus, Remus et Khaleesi a ravivé l’intérêt pour l’idée de la « de-extinction », c’est-à-dire le retour d’espèces disparues. Bien que le projet soit admirable, il soulève autant de questions qu’il n’apporte de réponses.
Comment fonctionne la technologie de « résurrection » ?
Le projet repose sur la technologie CRISPR, un outil d’édition du génome qui permet d’apporter des modifications ponctuelles à l’ADN. Les scientifiques ont étudié d’anciens fragments d’ADN extraits de fossiles vieux de 13 000 et même 72 000 ans. Ils ont ensuite pris le matériel génétique de loups gris modernes — les parents vivants les plus proches des loups luths — et l’ont modifié en 20 endroits pour le rapprocher de l’espèce ancienne.
Il en est résulté des petits qui ressemblaient extérieurement à leurs « ancêtres » préhistoriques. Ils ont été élevés et mis au monde par des chiens domestiques ordinaires. Scientifiquement, il s’agit d’un hybride de loup gris et de traits reconstitués du loup luth.
Résurrection ou création d’une nouvelle espèce ?
Malgré les gros titres, la plupart des scientifiques indépendants sont prudents dans leurs évaluations. Comme l’expliquent les biologistes, la « résurrection » implique la reproduction exacte d’une espèce, et non la création d’un analogue similaire. Deux problèmes se posent à cet égard : premièrement, nous ne disposons pas du génome entièrement préservé des animaux disparus. Deuxièmement, le comportement, l’écologie et les aptitudes sociales ne dépendent pas seulement de la génétique, mais aussi de l’environnement dans lequel l’animal grandit.
Un hybride moderne, élevé en laboratoire dans des conditions artificielles, peut-il se comporter comme un loup sauvage ? Les experts en doutent. Même si les petits ressemblent à d’anciens prédateurs, ils ne pourront pas chasser comme leurs ancêtres. Non pas parce qu’ils ne le voudront pas, mais parce qu’il n’y aura personne pour leur apprendre.
À quoi tout cela sert-il ?
C’est là qu’intervient la partie la plus amusante. Si la « résurrection » en elle-même semble spectaculaire, son application potentielle à la conservation d’espèces vivantes mais menacées est bien plus importante. Colossal utilise déjà ses découvertes pour cloner des loups rouges, une sous-espèce rare dont le nombre est extrêmement faible. L’objectif est d’introduire de la diversité génétique dans les populations élevées en captivité afin de pouvoir les réintroduire dans la nature à l’avenir.
Le génie génétique peut également contribuer à préserver la diversité d’autres espèces vulnérables. En substance, il s’agit d’une tentative non seulement de lutter contre l’extinction, mais aussi de l’inverser. Cela semble-t-il ambitieux ? Oui, mais ce n’est plus aussi fantastique qu’il y a quelques décennies.
Limites réelles et questions ouvertes
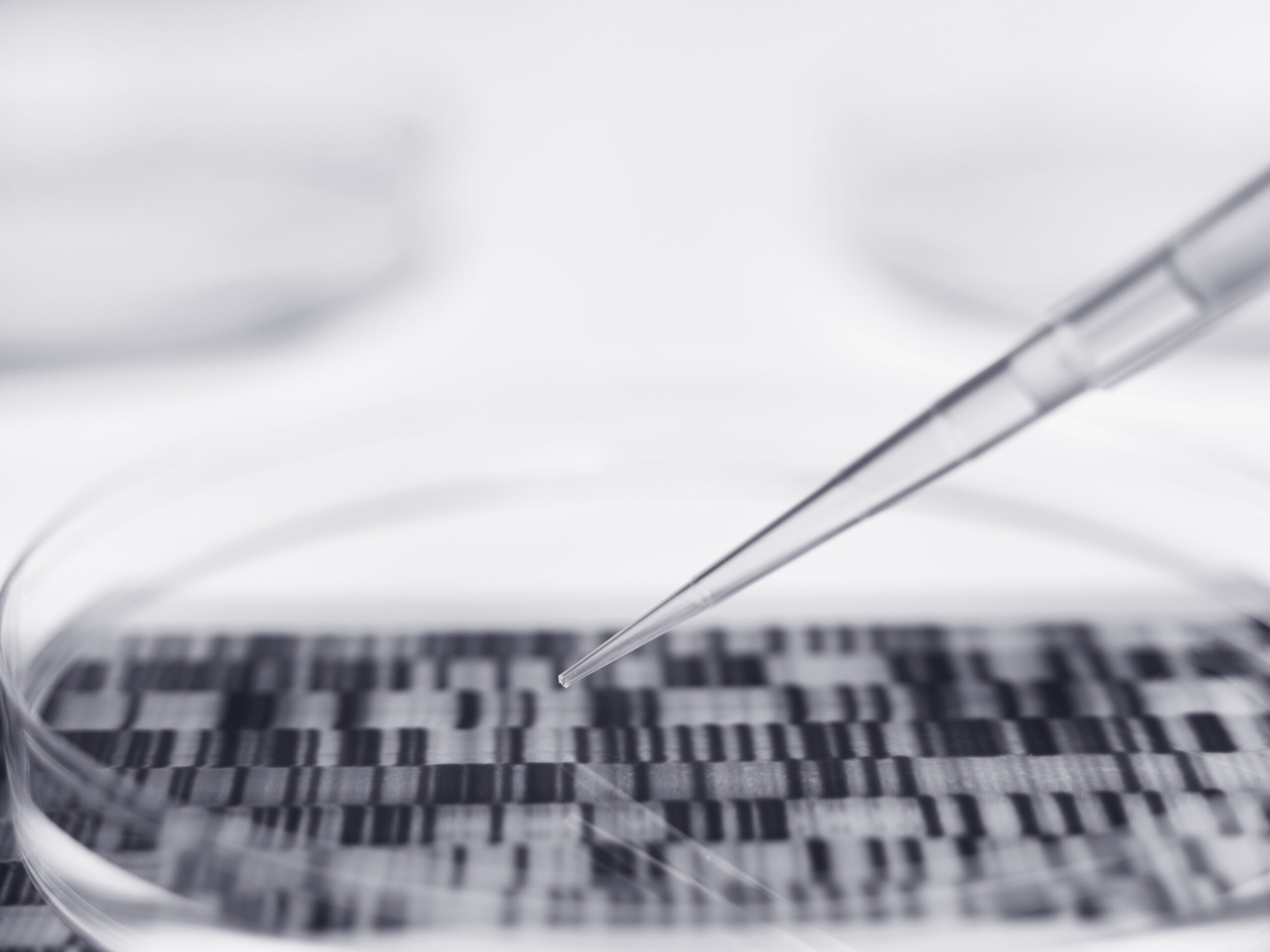
Malgré les avancées technologiques, la « deextinction » a sa part d’ombre. Tout d’abord, il y a le risque de créer des organismes qui n’ont pas leur place dans les écosystèmes modernes. Même si nous apprenons à reproduire les génomes, nous ne pourrons pas rétablir le climat, la chaîne alimentaire et les comportements du passé. Ces animaux seront « inaccoutumés », c’est-à-dire complets sur le plan biologique, mais étrangers sur le plan écologique.
Deuxièmement, des questions éthiques subsistent. Que faire des êtres créés ? Comment leur assurer une vie décente ? Ne s’agira-t-il pas d’une simple démonstration de puissance scientifique, plutôt que d’un véritable pas en avant vers l’équilibre écologique ?
Un nouvel outil, pas une baguette magique
L’apparition d’animaux génétiquement modifiés comme les loups sauvages n’est pas un retour définitif au passé, mais plutôt le signal que nous entrons dans une ère où l’homme peut non seulement protéger la nature, mais aussi la redessiner. Cependant, il est important de se rappeler que les technologies ne sont que des outils. Tout dépend de la manière dont nous les utilisons.
La « résurrection » d’espèces disparues n’annule pas la nécessité de préserver celles qui sont encore en vie. Au contraire, ces développements nous rappellent à quel point la frontière entre la survie et l’extinction peut être fragile. Et à quel point nous avons le temps — ou pas — de changer.